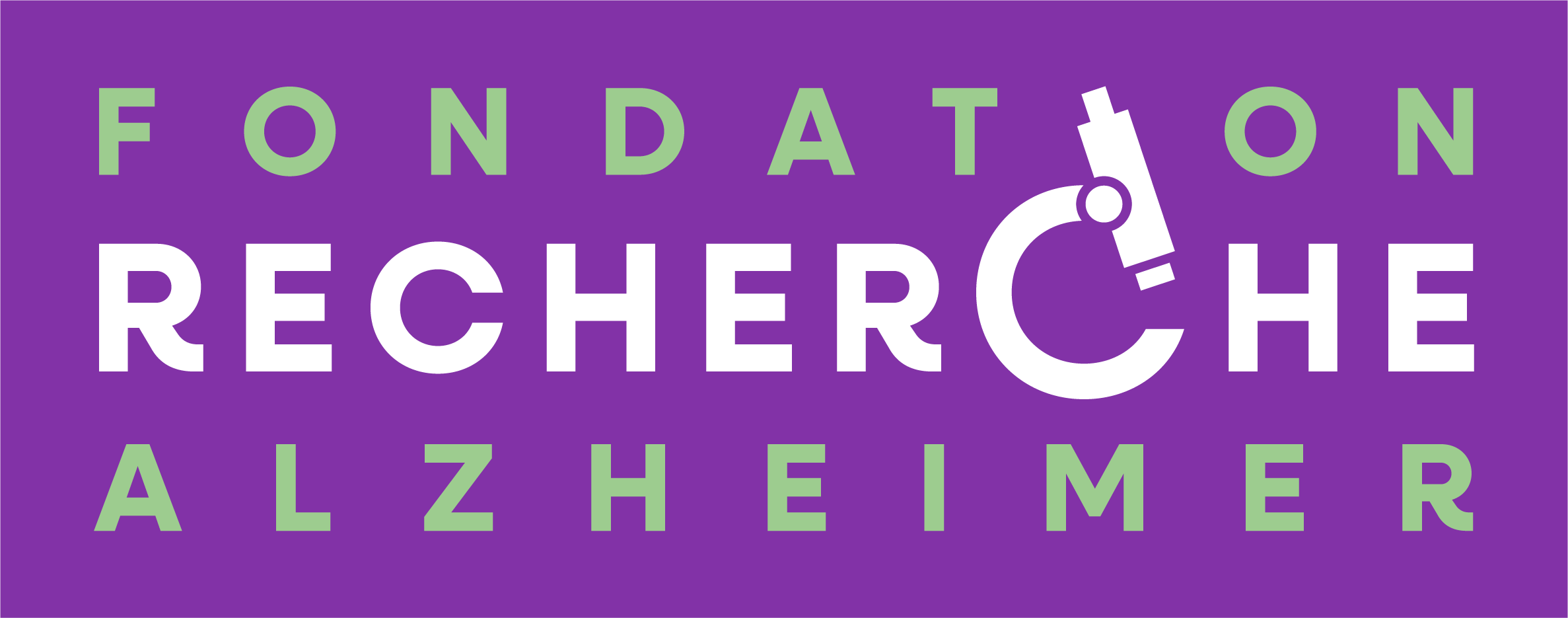Qu’est-ce que l’échelle de Reisberg et à quoi correspondent ses différents stades ?
Le premier médecin à décrire précisément l’évolution clinique de la maladie d’Alzheimer est le psychiatre américain Barry Reisberg, en 1982. Il relève sept stades principaux entre l’absence de troubles cognitifs et la démence très sévère. À chacun, correspond un niveau d’autonomie et des symptômes. Ces distinctions constituent l’échelle globale de détérioration (GDS), également appelée échelle de Reisberg. Cet outil est encore largement utilisé par les professionnels pour évaluer l’état d’une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer, mesurer la progression de sa pathologie et guider son entourage dans la prise en charge.
- Stade 1 : tout va bien !
La personne ne présente aucun signe de la maladie d’Alzheimer. Les éventuels trous de mémoire sont à mettre sur le compte de l’âge, mais sont sans rapport avec un déclin cognitif. Bref, rien à signaler !
- Stade 2 : d’imperceptibles défaillances de mémoire…
Quasi indécelables, des troubles de la mémoire se manifestent de temps à autre : tantôt la personne peine parfois à trouver ses mots, tantôt elle confond les noms ou oublie où elle a posé ses clés… Pas de quoi altérer ses performances professionnelles ni ses relations sociales ! Il s’agit seulement d’un très léger déclin cognitif.
- Stade 3 : les troubles cognitifs perturbent le quotidien
Les troubles cognitifs commencent à retenir l’attention de l’entourage, car ils ont tendance à se répéter et s’intensifier : la personne se perd, égare ses objets, peine à se concentrer et à s’organiser, elle se répète et éprouve des difficultés à nommer les gens. Ses aptitudes au travail en pâtissent. Elle en prend elle-même conscience, ce qui engendre anxiété ou déni, selon les cas. Ce déclin cognitif léger précède la démence, mais n’en est pas. Des années peuvent s’écouler ainsi.
- Stade 4 : le diagnostic de maladie d’Alzheimer est posé
À partir de ce stade, la personne est considérée comme un malade Alzheimer. Tous les éléments sont réunis pour qu’un diagnostic puisse être posé, même s’il s’agit seulement de la phase précoce de la pathologie. De plus en plus fréquents, les troubles cognitifs prennent des formes variées : la personne a du mal à exécuter les tâches complexes ou résoudre des calculs mentaux, elle oublie les événements récents, des éléments de son propre passé lui échappent… Ces difficultés génèrent facilement des sautes d’humeur. La personne reste néanmoins capable de s’occuper d’elle, de s’orienter dans le temps, dans les espaces connus et de reconnaître les visages familiers.
- Stade 5 : le début de la dépendance
La personne ne parvient plus à exécuter seule certaines tâches quotidiennes (préparer des repas, choisir ses habits). Même si elle gère encore ses besoins élémentaires (manger, aller aux toilettes), elle ne peut plus être considérée comme autonome et ses proches doivent réorganiser sa vie pour qu’elle bénéficie d’une aide à domicile. Contrairement aux informations de la vie courante (ses coordonnées, la date…), les éléments de son passé (faits majeurs de sa vie, noms de ses proches…) résistent.
- Stade 6 : l’apparition des troubles du comportement
La plupart des activités quotidiennes (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) requièrent maintenant une assistance. La question de l’entrée en institution se pose de façon d’autant plus pressante qu’aux troubles de mémoire aggravés, se mêlent souvent des troubles du comportement, qui compliquent fortement la vie à domicile : agitation, errance, hallucinations, défiance, agressivité, symptômes obsessionnels…
- Stade 7 : la fin des interactions
Progressivement s’installe une tension musculaire rendant la personne incapable de se déplacer ou d’interagir (parler, sourire). Une assistance devient indispensable pour l’ensemble de ses besoins. Cette phase finale de la maladie peut durer un à trois ans aboutissant au coma mais le patient est souvent victime d’une complication : embolie, « fausse-route », infection ».
Conclusion : Cette échelle définie en 1982 est-elle toujours un instrument pertinent ? Le recours à cet outil a cependant été critiqué en 2022 par la Fédération des Centres Mémoire comme étant un instrument daté et imparfaitement validé. Son défaut est qu’il repose sur l’idée que ces maladies suivent chez tous les patients une progression identique. On sait maintenant qu’elles sont bien plus hétérogènes dans leur évolution. Des sujets atteints de formes rares de MA, par exemple les formes frontales ou visuelles débutantes de MA, pourraient passer à travers ce crible, avec pourtant un déficit visuo-spatial ou de l’attention altérant considérablement la capacité à conduire. Quant aux maladies apparentées – maladie à corps de Lewy, dégénérescence lobaire fronto-temporale- couvertes par ce décret, le recours à cette échelle y paraît encore moins légitime. Cette décision a au moins le mérite d’alerter, et de proposer un repère, mais rien ne remplace une évaluation individuelle par des équipes spécialisées, malheureusement trop peu nombreuses.
The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7114305/
Pour en savoir plus sur les symptômes et le diagnostic de la maladie d’Alzheimer : https://alzheimer-recherche.org/la-maladie-alzheimer/symptomes-et-diagnostic/