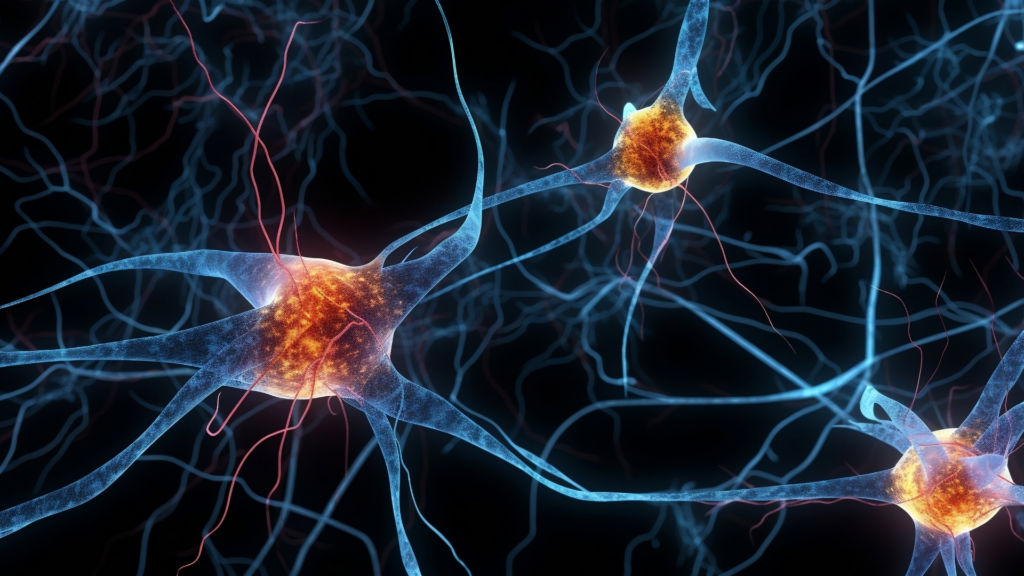La maladie d’Alzheimer est-elle héréditaire ?
Article rédigé par le Docteur Olivier de Ladoucette, Président de la Fondation Recherche Alzheimer
La maladie d’Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus répandue et la première cause de dépendance chez les seniors. Lorsque plusieurs membres d’une famille sont touchés par cette maladie, il est naturel de se demander si l’hérédité en est la cause. Dans cet article, nous examinerons les aspects génétiques de la maladie d’Alzheimer et clarifierons les liens potentiels entre la génétique et la pathologie.
La première chose à comprendre est qu’il existe deux formes distinctes de la maladie d’Alzheimer sur le plan génétique. Bien que ces deux formes présentent des symptômes similaires, elles diffèrent par l’âge de début et n’ont pas les mêmes causes.
La maladie d’Alzheimer sporadique.
La forme la plus courante de la maladie d’Alzheimer est dite « sporadique ». Elle représente plus de 99% des cas. Les premiers symptômes de cette forme se manifestent généralement après l’âge de 65 ans, et plus fréquemment après 70 ou 75 ans. Bien qu’il puisse y avoir plusieurs cas de la maladie au sein d’une même famille, cela est souvent attribué au principal facteur de risque : l’âge. En effet, plus une personne avance en âge, plus son risque de développer la forme sporadique de la maladie d’Alzheimer augmente. Ce risque passe de 5% à l’âge de 65 ans à plus de 15% après 85 ans. Par conséquent, il n’est pas rare qu’une famille dont la plupart des membres vivent jusqu’à un âge avancé compte un ou deux aînés atteints de la maladie d’Alzheimer. Il est important de noter que d’autres facteurs de risque, liés au mode de vie (sédentarité, tabagisme, etc…), à l’environnement ou à la génétique, peuvent également contribuer à augmenter ce risque. En effet, certains gènes sont aujourd’hui connus pour augmenter (un tout petit peu) le risque de développer la forme sporadique de la maladie d’Alzheimer. Cependant, la présence de ces gènes dans le patrimoine génétique d’une famille n’est ni nécessaire ni suffisante pour provoquer la maladie. Les chercheurs les désignent comme des gènes de « susceptibilité ». Le plus connu d’entre eux est le gène Apoe4. Être porteur d’un gène Apoe4 augmente le risque de développer la maladie d’Alzheimer, mais c’est encore plus flagrant lorsque les deux gènes de la paire sont des gènes Apoe4. Pour autant, si leur présence augmente bien le risque de survenue de la maladie, elle ne se déclare pas à coup sûr et à l’échelle d’une population, de nombreuses personnes porteuses de l’Apoe4 ne déclareront jamais la maladie !
La maladie d’Alzheimer héréditaire
La deuxième forme, la maladie d’Alzheimer héréditaire, est beaucoup plus rare (moins de 1% des cas). Cette forme se distingue par son apparition précoce, avant l’âge de 65 ans et parfois même avant 50 ans. Elle est directement liée à une anomalie génétique, le plus souvent une mutation de gènes tels que la préséniline 1, la protéine précurseur du peptide amyloïde (APP) ou la préséniline 2. La conséquence commune des mutations génétiques est une augmentation de la production du peptide amyloïde. Ces découvertes sur les gènes responsables ont débuté dans les années 1990 et se poursuivent encore aujourd’hui.
Quelles sont les conséquences de cette forme héréditaire ? Quand un membre de la famille est atteint, il transmet le gène muté à 50 % de ses descendants. C’est pourquoi lorsqu’une maladie d’Alzheimer est diagnostiquée précocement, le médecin peut proposer de réaliser un arbre généalogique, afin de mieux repérer les éventuels membres de la famille également touchés. Si cela révèle une possible transmission héréditaire, se pose alors la question de faire un test génétique à la recherche d’un gène muté…
Pour qui le diagnostic génétique ? Une recherche de cause génétique de la maladie d’Alzheimer peut être proposée lorsqu’au moins deux apparentés du premier degré (frère/sœur, parent) présentent (ou ont présenté) une maladie d’Alzheimer dont l’âge de début des premiers symptômes est inférieur ou égal à 65 ans pour chacun. Ou encore, lorsqu’un membre isolé de la famille présente une maladie d’Alzheimer dont l’âge de début des premiers symptômes est inférieur ou égal à 50 ans. Le diagnostic moléculaire nécessite un consentement informé, signé spécifiquement par le patient sauf s’il est sous tutelle, auquel cas il est obligatoire d’obtenir l’accord du tuteur légal pour pratiquer cet examen.
Conclusion
En conclusion, la forme sporadique de la maladie d’Alzheimer, de loin la plus fréquente, doit être considérée comme une maladie multifactorielle. Dans la forme sporadique, l’âge est le principal facteur de risque, et d’autres facteurs (génétiques, de mode de vie, d’environnement…) jouent également jouer un rôle. La forme héréditaire, beaucoup plus rare, est liée à des anomalies génétiques spécifiques et se manifeste à un âge précoce. La recherche continue de progresser dans la compréhension approfondie des facteurs de risque et de l’hérédité, ouvrant la voie à une prévention adaptée ainsi que des thérapies plus efficaces.
Le rôle des gènes dans Alzheimer en cinq questions
Source : Source Molecular Neurodegeneration