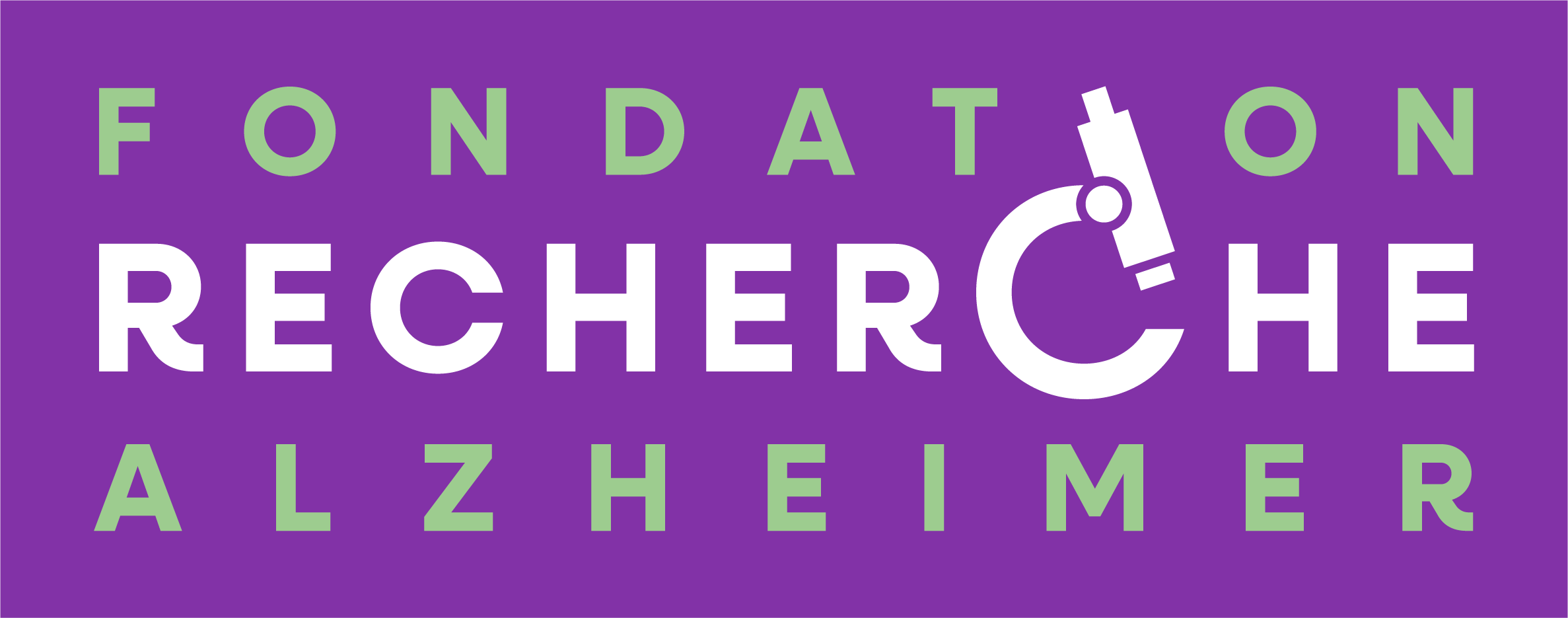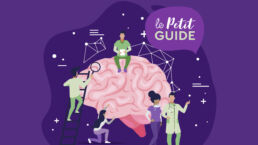Guide complet pour une transition réussie vers une institution spécialisée pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
Par le Dr Olivier de Ladoucette
Lorsque la maladie d’Alzheimer progresse, les familles se retrouvent généralement confrontées à une décision délicate : l’entrée en institution spécialisée. Cette transition, bien que redoutée, peut être abordée de manière proactive et bienveillante pour assurer le bien-être tant du patient que de ses proches. Pour cela, il est essentiel d’éviter certains pièges courants. Voici nos conseils pour gérer cette étape au mieux :
- Anticiper plutôt que subir
Il est crucial de comprendre que l’entrée en institution devient souvent inévitable à mesure que la maladie progresse. Repousser la décision ne fait que compliquer les choses. Au contraire, en initiant les démarches suffisamment tôt, les familles ont le temps de choisir l’établissement le mieux adapté aux besoins du patient. Il est recommandé de commencer les recherches dès que les premiers signes indiquent que le maintien à domicile devient difficile. Cela permettra d’éviter une admission dans l’urgence et de trouver l’établissement le plus adapté en termes de prix, de soins, de lieu…
- Inclure le patient dans le processus
Une erreur fréquente est de cacher à la personne atteinte d’Alzheimer sa future entrée en institution, sous prétexte de la préserver. Cette façon de procéder peut provoquer des réactions traumatisantes lors de l’admission. Une entrée mal préparée ou forcée risque de favoriser un « syndrome de glissement », où la personne, traumatisée par cette brusque perte de repères lâche et se laisse doucement mourir. Sans en arriver là, il arrive souvent qu’un résident mal préparé à son arrivée dans l’EHPAD régresse : il refuse de s’alimenter, devient incontinent, dort mal… Il est donc préférable d’impliquer le patient dans la prise de décision autant que possible. Bien qu’il puisse ne pas être en mesure de choisir lui-même, lui parler de ce changement et l’emmener visiter les établissements peut faciliter son adaptation.
- Combattre la culpabilité
Beaucoup de proches se sentent coupables de placer un être cher en institution. Il est important de comprendre que cette décision est souvent inévitable et ne devrait pas être perçue comme un abandon. Si vous êtes contraints de confier votre parent à un établissement, la faute revient à la maladie, en aucun cas à vous. Au contraire, en confiant le patient à des professionnels qualifiés, les proches peuvent retrouver une certaine sérénité dans leur relation avec lui. Le rôle de l’aidant ne s’arrête pas au seuil de l’EHPAD, il évolue.
- Dépasser les préjugés
Les maisons de retraite sont souvent associées à des images négatives, perçues comme des lieux de fin de vie. Cependant, de nombreux établissements spécialisés offrent un environnement chaleureux et sécurisé, favorisant le bien-être et la stimulation des résidents. Il est essentiel de se défaire de ces préjugés pour envisager cette transition de manière positive.
En adoptant une approche proactive, inclusive et dénuée de préjugés, l’entrée en institution pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer peut être une transition positive et bénéfique pour tous. En planifiant soigneusement cette étape et en impliquant le patient autant que possible, les familles peuvent s’assurer que leur proche reçoit les meilleurs soins et bénéficie d’un cadre de vie adapté à ses besoins spécifiques.
Et si pour des raisons matérielles, psychologiques ou sociales, le modèle de la maison de retraite n’est pas adapté, il existe des solutions alternatives.
Découvrez notre site dédié aux aidants, avec un guide gratuit à télécharger : Unis contre Alzheimer.